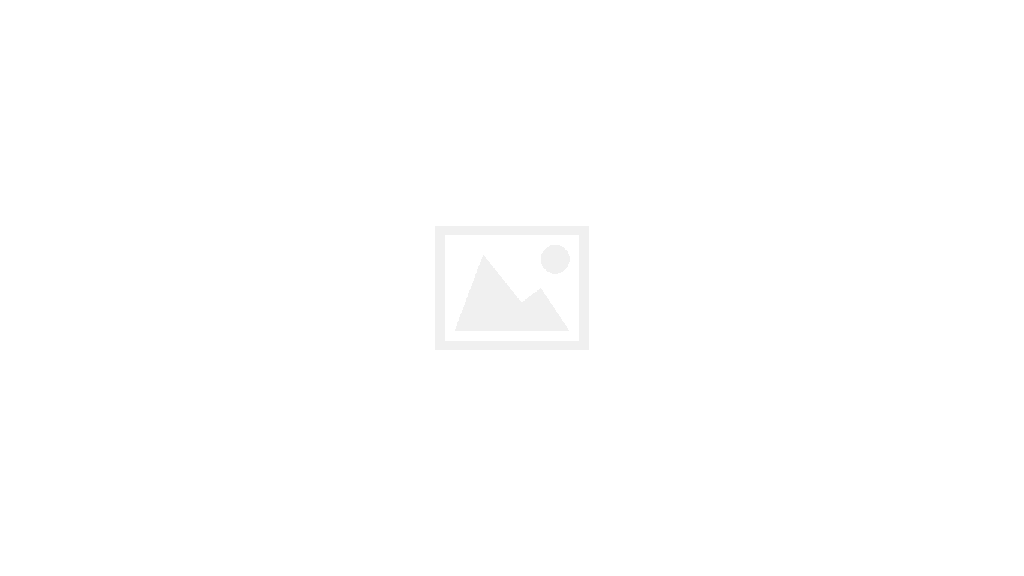Au moment où Peter Coulter trancha, à l’aide de son couteau, la gorge du mouton, il eut l’étrange impression que ce qui venait de se passer là s’y était déjà passé autrefois. Impression troublante ! Un rideau, dans la partie obscure de son esprit, sembla s’écarter, l’espace d’un instant, et lui montrer, parmi les brumeuses collines du Wiltshire, un autre lui-même, qui regardait les yeux vitreux du mouton et le sang chaud giclant sur sa main. Il était envahi par des émotions sans lien avec sa vie, oppressé par la sensation d’être en dehors du temps. L’humidité du lieu s’insinuait dans ses os et l’air glacé soufflait à travers son cerveau. Il se sentait aussi enraciné en cet endroit que le chêne noueux profilé sur l’horizon, à cent yards de là, ou que les affleurements de calcaire qui se détachaient en blanc sur la terre trempée. Il avait cessé d’être Snowy Coulter, renvoyé du front à un centre d’instruction pour mitrailleurs ; il était un autre. Et il avait oublié d’où il venait et quelle était sa mission. Cette impression ne garda toute sa vivacité que pendant un instant, mais il en fut violemment affecté. Sa main tremblait tandis qu’il fendait avec son couteau le ventre du mouton et détachait la peau tiède.
« Qu’est-ce qui te prend ? Qu’est-ce qui ne va pas ? se demandait-il à lui-même. N’aurais-tu plus de cran, par hasard? Ce n’est pourtant pas la première fois que tu as le sang d’un mouton sur les mains ! »
Et il pensa au souper qu’il préparerait quand il rapporterait, en fraude, au camp, les morceaux de choix du mouton et à l’accueil que lui feraient ses camarades de baraque.
« Cette vieille canaille de Snow ! Qu’est-ce qu’il rapporte là ? Tu auras encore été à la maraude des « souvenirs » ? Pour sûr, c’est toi le roi des débrouillards… »
Évidemment, c’était l’effet d’une illusion si les contours embrumés des collines lui avaient semblé un instant aussi familiers que les bords du Loddon. Il avait déjà passé par des moments semblables, mais jamais aussi écrasants. Suspendant un instant son travail, il regarda par-dessus son épaule pour s’assurer que personne ne l’observait et ses yeux, plissés par le vent, embrassèrent les longues ondulations de terre cultivée presque entièrement dépouillées de tout arbuste ou buisson. Bien qu’on fût au début de l’après-midi, aucun être humain n’était en vue. Le camp était établi, derrière un rideau d’arbres, à trois milles de là et, parsemés au premier plan, se trouvaient des bois minuscules, des fermes, des villages ; mais le brouillard léger qu’exhalait la terre fondait tous les contours de telle façon que rien ne se détachait crûment, rien, sinon, sur le terrain crayeux, les sentiers de moutons qui traçaient des raies pâles à travers les espaces verts.
Peter, en route vers un village voisin, suivait un raccourci à travers champs, lorsqu’il avait aperçu le mouton, prisonnier d’un buisson de ronces où sa toison était accrochée et, tout de suite, il avait vu, en cet animal, de la nourriture. Avoir enfin, un jour, de la viande fraîche ! Et de quoi contenter largement tout le monde ! Il était obsédé par une fringale qui n’avait jamais été tout à fait apaisée depuis son débarquement en Angleterre. Ses camarades tournaient en plaisanterie cet insatiable appétit. Il lui arrivait souvent de se glisser la nuit jusqu’au bois bordant le camp pour essayer de prendre un lapin au collet ; mais, le plus souvent, c’était sans succès. Deux fois dans une même quinzaine, la chance lui avait souri et il y avait eu festin dans la baraque, tous les hommes groupés autour de lui humant l’odeur épaisse de la gibelotte qu’il cuisait sur le poêle, dans le seau à incendie. Mais un lapin, ce n’était guère pour tant de gens et, bientôt, la faim l’avait repris, son imagination évoquant de grands fromages, de lourds quartiers de bœuf, des miches de pain de ménage, toute la nourriture substantielle que, depuis sa prime jeunesse, il avait été habitué à voir en quantités illimitées.
Que des hommes faits pussent avoir faim, cela lui paraissait scandaleux, beaucoup plus scandaleux que de tuer un mouton tombé par hasard entre ses mains. Il n’éprouvait pas le moindre remords à ce sujet. C’était l’affirmation d’un droit naturel et, tandis qu’il détaillait la carcasse en morceaux, il éprouvait un sentiment plus vif de sa dignité d’homme qu’en absorbant dans la baraque du mess son assiettée de ragoût trop clair.
« Ce soir, aucun des camarades ne se couchera sans avoir fait un bon repas, se dit-il, avec un petit rire. Et, ainsi, ils seront moins portés à se moquer de mon appétit… Je vais cacher des morceaux çà et là ; et, en rentrant, je passerai les meilleurs en fraude, dans mon manteau… »
Pourquoi la sensation d’avoir déjà agi ainsi traversa-t-elle de nouveau son esprit, comme un éclair ? L’odeur de la peau fraîche et de la laine graisseuse pénétrant quelque lointaine cellule de son cerveau y éveillait-elle des souvenirs ? Non des souvenirs d’enclos à moutons de la ferme paternelle, sur les bords du Loddon, en tout cas ! Quelque chose de plus voilé, de plus vague, et lié au paysage même qu’il regardait.
Un paysage véritablement étranger ! Il se rappelait fort bien comment il en avait été affecté lorsqu’il l’avait vu pour la première fois, deux ans auparavant dans un brouillard humide. Il s’était mis en marche, avec sa compagnie, au sortir du train qui les avait amenés du bateau ; trois milles d’ennuyeux cheminement et il avait eu l’impression que le ciel gris était descendu tout près de la terre et fondait en elle. Autour d’eux, des arbres dénudés ; sous leurs pieds, des feuilles détrempées ! Et puis les collines rondes et tondues sur lesquelles les nappes de brouillard se fixaient comme de la neige. Rien n’avait ces contours précis inséparables, dans son esprit, de la santé et de la force et, lorsque les affreux toits métalliques du camp d’instruction avaient surgi devant eux, saisi d’un violent accès de mal du pays, il avait ardemment souhaité revoir les gommiers des rives du Loddon dressés dans la clarté du soleil matinal.
Ces arbres lui revinrent à l’esprit lorsqu’il reprit sa marche vers le village, et ses pensées oscillèrent confusément de l’un à l’autre de ces deux mondes si profondément différents. Il était en route pour rendre visite à certains parents de son père qui habitaient le village et il trouvait bizarre d’être le chaînon reliant ces collines au Loddon. C’était vraiment une chose comique ! Jusqu’à l’année précédente, il avait ignoré l’existence d’Elias ou de la tante Jupp ; pourtant, ils étaient là, tout un nid de parents dont quelques-uns portaient son nom et qui, tous, lui rappelaient certaines particularités, certains traits de famille. Le nez de Martha, n’était-ce pas celui de tante Rachel tout craché, en dépit du fait qu’elles étaient si différentes quant à tout le reste ?
« Le monde est un vrai salmigondis, se disait-il, la main sur la barrière d’une petite maison paysanne. C’est bien ici le dernier endroit où j’aurais été chercher la principale racine de notre arbre généalogique. L’un des derniers, en tout cas. »
La maison, située en bordure du village, était petite et couverte de verdure, tellement que les croisées et la porte disparaissaient en partie sous le lierre. Peter fut reçu par une femme d’âge mûr, d’aspect timide et qui lui fit bon accueil, plutôt par ses mouvements et ses gestes qu’avec sa langue.
« Ah ! Vous voilà qui revenez nous voir, Peter. Allons, entrez ! La tante Jupp est restée levée aujourd’hui. C’est son anniversaire. Aujourd’hui même, elle prend ses quatre-vingt-quatorze ans. »
Elle semblait un peu effrayée par la grande taille de Peter et son uniforme étrange, son regard vacillait chaque fois qu’il la regardait ; mais on ne pouvait se tromper sur la chaleur de sa bienvenue au soldat. S’emparant de son lourd manteau, elle l’introduisit dans l’accueillante salle commune qui sentait la fumée de charbon et la cuisine et dont la faible lumière lui révéla une vieille, toute ridée, assise auprès du feu. C’était l’unique survivante des anciens de la famille, sourde, l’esprit un peu égaré, mais cramponnée à la vie avec autant de ténacité que la carapace cornée d’un criquet à l’écorce d’un arbre.
« Voici Peter qui vient vous voir, cria Martha, penchée sur elle. Vous vous rappelez Peter, tante Jupp ? Il est déjà venu ici. »
La vieille leva vers Peter des yeux excessivement brillants et sa langue émit un gloussement inarticulé ; mais, sitôt après qu’il l’eut saluée, elle parut oublier sa présence et retomba dans sa contemplation attentive des tisons.
Peter se laissa tomber sur une chaise, de l’autre côté du foyer, et déboutonna sa tunique, en sentant la chaleur l’envahir tout entier. Ah, la chaleur ! Elle lui montait à la tête comme les vapeurs du vin et faisait défiler de joyeuses visions devant son œil intérieur. Il avait envie de laisser aller sa langue, de plaisanter avec cette femme timide et mûre, occupée à mettre le couvert.
Il avait envie de dire : « Savez-vous ce qui m’est arrivé en traversant les pâtures ? Je suis tombé sur un mouton accroché dans des ronces. Parlez-moi d’une aubaine ! Je n’ai pas rencontré pareille chance depuis que je suis débarqué ici. J’aurais pu vous apporter un beau morceau de mouton si seulement j’y avais pensé. »
Mais quelque chose le retint, modéra la manifestation de son entrain. Dans cet entourage, le son de sa propre voix lui semblait étrange, un peu trop fort et trop rude. Depuis des générations, le bruit de la vie avait dû arriver assourdi à cette petite maison, et l’on sentait une retenue jusque dans le tic-tac de la grande pendule de bois posée sur la cheminée. Pour Peter, c’était comme un étang calme et sans rides après le bruit et la brutalité du camp, les ordres hurlés, le cliquetis des assiettes d’étain à la cantine, le crépitement des fusils-mitrailleurs au champ de tir.
Il promena autour de la pièce un regard aigu et agité, comme s’il cherchait à découvrir le secret de sa douce et chaude solidité. Les murs revêtus de plâtre, où se voyaient des taches d’humidité, semblaient avoir été construits en vue d’amortir le son et aucune voix du monde extérieur ne pouvait pénétrer par la croisée, scellée par la coutumes des générations. Les rideaux, les petits tapis de laine, les carrés de broderie, les chiens de porcelaine et autres bibelots, tout appartenait à un autre âge ; de même les tableaux pendus au mur. Cinquante années avaient dû bien peu modifier cette pièce, et peut-être cinquante autres la laisseraient-elles encore toute pareille.
Cinquante ans ! Il frissonna comme si un souffle venu de la tombe eût passé sur lui. La vie, pour lui, c’était du mouvement, du changement, le labour de nouveaux champs.
« Approchez votre chaise de la table, dit Martha ; vous devez être affamé, après cette course… Il n’y a pas beaucoup à manger au camp, je suppose.
– Pas trop, fit Peter, qui pensa au mouton mort. Le soir, nous nous couchons souvent sur notre faim. Nous avons toujours faim, nous autres piocheurs.
– C’est une vie terrible, la vie des soldats, dit Martha de son ton chantant. Ici, Dieu merci, nous avons de bonnes choses à manger et tant qu’il nous en faut – jusqu’à présent, du moins. Elias bêche ses légumes, matin et soir, avant d’aller à son ouvrage et en en revenant… Le voilà justement qui rentre. »
Elias était un homme d’une cinquantaine d’années, lourd, aux jointures rouillées et qui marchait comme si l’humidité avait pénétré jusque dans ses os. Son pantalon de velours à côtes était jauni par la terre, depuis les genoux jusqu’en bas et ses gros souliers étaient couverts d’une couche de boue. Sur lui, cela semblait une chose de nature, non une chose dont il eût pu se débarrasser. On aurait dit qu’il avait stationné si longtemps sur la terre mouillée qu’il s’y était enraciné comme un arbre ou un pieu.
« Eh bien, Peter, dit-il, en écartant sa chaise de la table, cette guerre, ça dure toujours ? »
Puis, saisissant son couteau et sa fourchette avec des doigts maladroits, il se pencha sur son assiette. Si son dos était un peu voûté, ses yeux bleus étaient limpides comme ceux d’un petit enfant et, en regardant son visage rose aux moustaches tombantes couleur de paille, on songeait à un fruit mûrissant. La lenteur de son parler faisait presque souffrir Peter. Apparemment, le jeu de son esprit n’était pas plus facile que celui de ses articulations.
« La tante Jupp célèbre son jour de naissance, dit-il, inclinant la tête vers la vieille assise au coin du feu. C’est la première fois qu’elle se lève depuis la fin de l’été. Elle prend ses quatre-vingt-quatorze ans aujourd’hui même. »
Presque tout le poids de la conversation reposait sur Peter. Il parla, avec une énergie saccadée, de la maison paternelle sur le Loddon, évoquant l’image des prés au bord de la rivière et des champs au temps de la moisson ; mais ses paroles tombaient à plat, sans éveiller aucun intérêt. C’était comme si on eût jeté des cailloux dans un puits profond, et attendu, en vain, le bruit, de l’eau frappée.
Il semblait y avoir, dans la calme personne d’Elias, d’insondables profondeurs. À quoi pensait-il, assis, la tête penchée sur son assiette, tandis qu’il mastiquait gravement et, de temps à autre, déplaçait un peu ses lourds souliers sur le carreau ? À rien, peut-être ! Ses yeux, bien que doux, étaient aussi dénués d’expression que s’ils eussent été faits de verre coloré.
Une fois, pourtant, une lueur d’intérêt les traversa.
« L’Australie ! dit-il, comme si ce mot avait touché un point sensible de sa mémoire. Ah ! oui, j’ai failli y aller autrefois. J’étais alors un jeune gars et j’avais dans l’idée de voir du pays. Dans ce temps-là, j’étais porté vers les bateaux et l’oncle Verney, qui était marin, m’aurait bien procuré un passage. On a trouvé, pourtant, que c’était trop loin. La. tante Jupp, ici présente, ne voulait pas en entendre parler… C’était trop loin. Trop de gens de la famille étaient partis au-delà de la mer et n’étaient jamais revenus. »
Néanmoins, Elias semblait tirer un tranquille plaisir du fait qu’il aurait pu être l’un de ceux-là. Il tournait et retournait cette pensée dans sa cervelle comme une vache rumine. Après au moins cinq minutes de réflexion, il dit avec un rire timide :
« J’aurais peut-être, à présent, un ranch à moi si je n’étais pas resté au pays à ce moment-là. Je serais peut-être revenu ici, riche, et j’aurais dépensé de l’argent dans les hôtels et fréquenté le grand monde. »
Peter attaqua les crumpets (1) grillés et s’amusa de cette pensée ; mais, peu à peu, les yeux d’Elias redevinrent opaques. Visiblement, le sujet avait cessé de l’intéresser. Son imagination n’avait jamais été habituée à s’exercer longtemps de suite. Des tisons ardents s’élevaient de petites flammes qui dansaient sur la vaisselle blanche, sur la nappe neigeuse et sur le visage ridé de la tante Jupp, toujours immobile sur son siège, près du feu. Parfois un écho de la conversation semblait arriver jusqu’à elle et, une fois, elle appela Martha d’un geste.
« Qu’est-ce qu’ils disent, Martha ?
– Rien, tante Jupp. Ils parlent de la guerre. »
À ce mot, une lueur de vie éclaira le visage de la vieille femme et sembla faire vibrer en elle quelque corde sensible. Ses doigts entrelacés se crispèrent et elle marmotta quelque chose d’incohérent au sujet d’un certain Thomas qui avait été tué avant d’avoir ses vingt ans.
« Et sa mère même n’a pas su où on l’avait enterré, » répétait-elle.
Son nez et son menton se rejoignirent et elle persuada Martha de lui apporter certaines lettres jaunies qui se trouvaient dans un tiroir au coin de la pièce.
« Y en avait tout un tas… Elles sont jaunes, aujourd’hui et il n’y a plus personne pour les lire ! »
Il devint peu à peu évident pour Peter que cette guerre, objet de ses méditations, s’était passée, de longues années auparavant, en Crimée. Dans l’atmosphère où il se trouvait, son propre sens du temps devenait confus et ses perspectives si nettes et bien définies s’oblitéraient. De même, lorsqu’on regardait, à travers le plateau ondulé, les boqueteaux et les petits villages à demi-perdus dans le brouillard, on ne savait trop s’ils étaient éloignés d’un mille ou de dix. Tandis qu’il observait Elias, Martha et la vieille femme au coin du feu, à la pensée qu’ils étaient, eux et lui, de même sang, il éprouvait une sensation bizarre, spectrale. En dépit de la chaleur et du confort qui satisfaisaient son corps, son esprit était pénétré par un vent aigre qui s’insinuait à travers les fentes. Il ne possédait que de très vagues notions sur la façon dont ces gens lui étaient apparentés. Martha était peut-être cousine germaine de son père et Elias était son frère ; mais où s’intercalait la vieille femme ? Il ne s’était jamais tracassé au sujet des parentés, ni intéressé le moins du monde à son arbre généalogique ; mais, ici, ces choses prenaient une nouvelle signification. Une famille ressemblait vraiment à un arbre enraciné dans la terre et portant des feuilles toutes de même forme.
« J’aimerais mieux tout couper et pousser en terre des racines qui seraient à moi, » se disait-il, rebelle.
Mais, malgré cette affirmation de son moi, il était obsédé par l’impression d’être contraint, asservi. Qui donc était-ce, ce Snowy Coulter avec ses deux galons sur sa manche et qu’une jeune fille attendait, là-bas, sur le Loddon ? Il avait l’odieuse sensation que sa personnalité était une petite chose, éphémère et vacillante, à côté du moule familial auquel la vieille au coin de feu devait de lui rappeler si étrangement son père.
Elle se leva enfin pour aller se coucher et Peter saisit cette occasion pour prendre congé. Comme il lui disait au revoir, elle posa un bras desséché sur son épaule et, de ses yeux étranges et perçants, elle le dévisagea. Toute une longue minute, cet examen un peu fou se prolongea.
« Tu ressembles à ton grand-père, marmotta-t-elle, en hochant la tête. Le même front qui avance, le même regard dans les yeux… Nous étions trois et il était l’aîné. Lui aussi, c’était un beau garçon, planté bien droit. »
Sa voix enrouée, surgie de quelque obscur passé, déconcertait Peter presque autant que son regard de pythonisse et sa façon de lui serrer l’épaule. Il eut un rire saccadé :
« C’était il y a bien longtemps, tante Jupp. Il est mort avant ma naissance, bien des années avant. Jamais je n’ai entendu le père en parler. Je n’ai même su que j’avais des parents ici que très peu de temps avant de partir. Dans ma famille, on ne sait pas trop bien garder le contact avec la parenté. »
Il avait élevé la voix pour surmonter la surdité de sa tante et elle résonnait avec la même cordialité que lorsqu’il s’adressait à ses camarades de baraque. Mais la vieille semblait à peine l’entendre. Sa main décharnée avait soulevé le rideau de la croisée et elle regardait au-dehors les vastes espaces qu’éclairait la lune.
« Un beau garçon, bien planté, sans tache ni défaut, répéta-t-elle. Mais, on l’a emmené, oui, on l’a emmené… Dommage qu’on ne l’ait pas laissé devenir soldat comme il le voulait et être tué dans les guerres.
– Venez donc, tante Jupp, dit Martha paisiblement, c’est l’heure de se coucher.
– Les ormes vont bientôt bourgeonner, reprit la vieille femme. Les petits oiseaux vont faire leurs nids dans les osiers, là-bas, sur la berge de la rivière.
– Allons, au revoir, dit Peter, la main tendue. Je reviendrai.
– Oui, reviens, répéta-t-elle. Tu es comme ton grand-père… Combien de fois je me suis promenée avec lui au bord de cette rivière, regardant le pluvier courir dans les prés. Lui, un gars qui avait toute sa taille et moi, une menue fillette, et combien de fois j’ai entendu le petit cri du lapin sous sa main ! Il aimait ça ; c’est ce qui a fait son malheur. On l’a emmené pour avoir tué un malheureux mouton, là-haut, sur les pâtures ; on l’a déporté au-delà des mers… Il disait : « Je reviendrai. » Mais il n’est jamais revenu. »
Elle parlait comme si elle avait devant les yeux quelque image plus nette que les objets qui l’entouraient et sa voix faiblit et vacilla sous l’émotion, ou, peut-être, sous le souvenir de l’émotion.
Elle répéta :
« On l’a emmené, déporté au-delà des mers.
– Venez donc, tante Jupp, supplia Martha. Vous prendrez froid. »
La vieille femme hochait la tête tandis que, d’un pas traînant, elle s’en allait au bras de Martha.
« Quatre-vingt-quatorze, marmonnait-elle. Ça fait quatre-vingts ans de ça… On l’a emmené, oui, on l’a emmené. »
*
Peter se retrouva dehors, sur la route, sous un brumeux clair de lune, et, bien que le temps ne fût pas froid, un frisson le traversa comme s’il eût été dépouillé de tous ses vêtements. L’air de la nuit semblait libérer les parfums du sol, l’haleine des guérets retournés, des prés imbibés d’eau, l’odeur de l’humus. Des lumières luisaient faiblement dans les maisons du petit village ; mais rien ne bougeait et l’on n’entendait aucun bruit. C’était comme si ce lieu tout entier fût tombé en léthargie ; et Peter éprouva brusquement le désir intense de revoir les visages de ses camarades et d’entendre leurs voix rudes et cordiales.
Il hésita, parcourant du regard les hauteurs, si immobiles sous le clair de lune et que rayaient çà et là les ombres des touffes d’ajoncs. Un sentier de moutons conduisait au camp dont il pouvait presque distinguer les faibles lumières ; mais il répugnait un peu à traverser ce grand espace silencieux sans autre compagnie que celle de ses pensées. La route n’était qu’à un mille plus loin. Il eut la vision soudaine du mouton, enveloppé dans sa peau, par terre, sous le buisson de ronces, de la tête séparée, des perles de rosée parsemant la lame ; mais, maintenant, réchauffé, l’estomac plein, il n’avait guère envie de s’en rapprocher. Quel plaisir pourtant cette viande aurait représenté pour ses camarades ! Et puis, zut ! Quant à lui, s’il devait ne pas dormir cette nuit, ce ne serait toujours pas parce qu’il aurait faim.
« Laissons les morts ensevelir les morts… » pensa-t-il, son esprit cherchant à se libérer de l’ombre qui pesait sur lui.
Et tournant sur sa droite, d’un pas vif, il s’engagea sur la route.
_____
(1) Gâteaux qu’on mange avec le thé. (Note de la trad.)
_____
(Vance Palmer, traduit par Marthe Nouguier, in La Revue hebdomadaire, tome XII, décembre 1934)